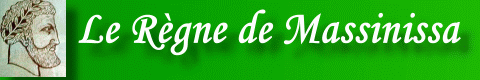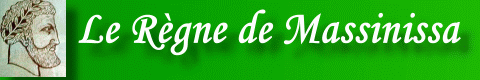La
Deuxième Guerre Punique

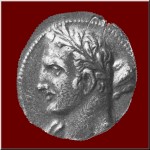 Hamilcar
Barca, qui avait dirigé le camp des vaincus en 241 av. J.-C.,
consacra le reste de sa vie à reconstruire la puissance de
Carthage en Espagne pour compenser la perte de la Sicile. Son fils
Hannibal devint commandant des forces carthaginoises dans cette région
en 221 av. J.-C., et, en 219 av. J.-C., il attaqua et prit Sagonte,
une cité espagnole alliée de Rome. Cet acte conduisit
à la deuxième guerre punique (218 av. J.-C.-201 av.
J.-C. Au printemps 218 av. J.-C., Hannibal conduisit une immense armée
composée aussi d'éléphants à travers l'Espagne
et la Gaule et lui fit traverser les Alpes pour attaquer les Romains
en Italie avant que ceux-ci ne puissent achever leurs préparatifs
de guerre. Il s'assura une position solide dans le nord du pays. Dès
216 av. J.-C., il avait remporté deux victoires importantes,
au lac Trasimène et à Cannes, et atteint le sud de l'Italie.
Hamilcar
Barca, qui avait dirigé le camp des vaincus en 241 av. J.-C.,
consacra le reste de sa vie à reconstruire la puissance de
Carthage en Espagne pour compenser la perte de la Sicile. Son fils
Hannibal devint commandant des forces carthaginoises dans cette région
en 221 av. J.-C., et, en 219 av. J.-C., il attaqua et prit Sagonte,
une cité espagnole alliée de Rome. Cet acte conduisit
à la deuxième guerre punique (218 av. J.-C.-201 av.
J.-C. Au printemps 218 av. J.-C., Hannibal conduisit une immense armée
composée aussi d'éléphants à travers l'Espagne
et la Gaule et lui fit traverser les Alpes pour attaquer les Romains
en Italie avant que ceux-ci ne puissent achever leurs préparatifs
de guerre. Il s'assura une position solide dans le nord du pays. Dès
216 av. J.-C., il avait remporté deux victoires importantes,
au lac Trasimène et à Cannes, et atteint le sud de l'Italie.
En dépit de ses demandes pressantes, Hannibal ne reçut
pas de renforts ni d'armes de siège en nombre suffisant de
Carthage jusqu'en 207 av. J.-C., lorsque son frère Hasdrubal
quitta l'Espagne avec une armée pour le rejoindre. Hasdrubal
franchit les Alpes, mais fut tué et ses troupes battues à
la bataille du Métaure, dans le nord de l'Italie. Entre-temps,
le général romain Publius Cornelius Scipio Africanus,
dit Scipion l'Africain, avait écrasé les Carthaginois
en Espagne et, en 204 av. J.-C., il débarqua avec une armée
en Afrique du Nord. Les Carthaginois rappelèrent Hannibal en
Afrique pour les défendre contre Scipion. À la tête
d'une armée de recrues mal entraînées, Hannibal
fut battu définitivement par Scipion à la bataille de
Zama en 202 av. J.-C. Cette bataille marqua la fin de la puissance
de Carthage et mit un terme à la deuxième guerre punique.
Les Carthaginois furent forcés de céder l'Espagne et
les îles de la Méditerranée encore en leur possession,
d'abandonner leur flotte de guerre et de payer une indemnité
à Rome.
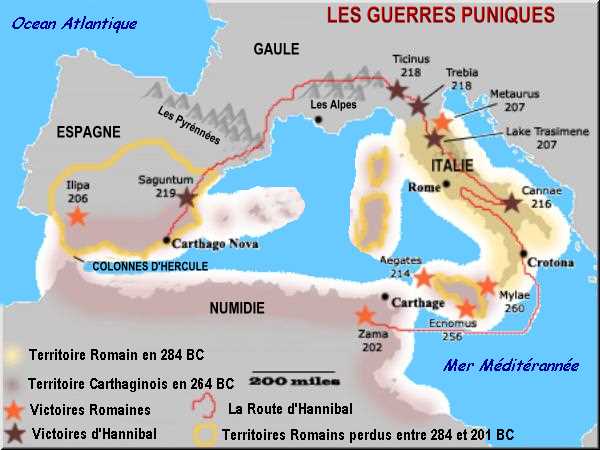 Ce fut l'affaire de Sagonte qui fournit l'occasion. Cette ville espagnole,
bien qu'elle fut l'alliée de Rome, excitait la convoitise des
Carthaginois en mal d' expansion dans la péninsule Ibérique.
C'etait maintenant le fils d'Hamilcar, Hannibal, qui avait pris la
tête de l'arme punique. Stratège inspire, grand admirateur,
comme tous les capitaines de l'Antiquité, d'Alexandre le Grand
et de Pyrrhus, fort averti avec cela de la culture grecque, Hannibal
était un homme tout àfait remarquable, que sa haine
viscérale de Rome poussait à aller toujours plus loin.
En 219, Sagonte investie tombait entre ses mains. Les Romains ne pouvaient
ne pas réagir. Sans trop y compter, ils exigèrent de
Carthage qu'on leur livre le violateur des accords passés en
226, définissant un nouveau partage des zones influence: les
Carthaginois avaient quelque peu mordu le trait... Ce fut, bien sur,
en vain : les Carthaginois étaient trop heureux de rendre aux
yens de Rome, si peu respectueux de leur signature, la monnaie de
leur pièce. On n'avait pas oublié les annexions abusives
de la Sardaigne et de la Corse. Il n'y avait donc plus qu'à
en découdre, ce qu'on envisageait des deux côtés
avec l'empressement que donne la foi en la victoire finale.
Ce fut l'affaire de Sagonte qui fournit l'occasion. Cette ville espagnole,
bien qu'elle fut l'alliée de Rome, excitait la convoitise des
Carthaginois en mal d' expansion dans la péninsule Ibérique.
C'etait maintenant le fils d'Hamilcar, Hannibal, qui avait pris la
tête de l'arme punique. Stratège inspire, grand admirateur,
comme tous les capitaines de l'Antiquité, d'Alexandre le Grand
et de Pyrrhus, fort averti avec cela de la culture grecque, Hannibal
était un homme tout àfait remarquable, que sa haine
viscérale de Rome poussait à aller toujours plus loin.
En 219, Sagonte investie tombait entre ses mains. Les Romains ne pouvaient
ne pas réagir. Sans trop y compter, ils exigèrent de
Carthage qu'on leur livre le violateur des accords passés en
226, définissant un nouveau partage des zones influence: les
Carthaginois avaient quelque peu mordu le trait... Ce fut, bien sur,
en vain : les Carthaginois étaient trop heureux de rendre aux
yens de Rome, si peu respectueux de leur signature, la monnaie de
leur pièce. On n'avait pas oublié les annexions abusives
de la Sardaigne et de la Corse. Il n'y avait donc plus qu'à
en découdre, ce qu'on envisageait des deux côtés
avec l'empressement que donne la foi en la victoire finale.
 Des
218, au printemps, l'armée d'Hannibal s'ébranla vers
l'Italie. Elle n'etait pas mince: 80 000 hommes bien entraînés
qu'il amenait d'Espagne, mais les Romains pouvaient en aligner 200
000. Pourtant, la marche du chef punique à travers les Pyrénées,
le Languedoc, la Provence et finalement les Alpes elles-mêmes,
fut une étonnante série de victoires. Son habileté
maneuvriere, la puissance de son armement, incluant les fameux éléphants,
['endurance de ses troupes semèrent chez les Romains, pourtant
aguerris, la déroute, voire, souvent la panique. Le consul
Cornelius Scipion subit les premiers revers des l'automne de 218 sur
le Tessin. Un mois plus tard, ce fut le tour de son collègue
Sempronius a la Trébie. Ce qui compliquait singulièrement
les choses, c'etait l'appoint que les Carthaginois recevaient fort
opportunément des Gaulois, si bien que les Romains durent évacuer
en catastrophe la Gaule cisalpine. Encore n'avaient-ils rien vu. L'année.
suivante, en 217, le consul Flaminius se laissa surprendre en plein
brouillard au plus mauvais endroit: coinces entre le lac Trasimène
et les collines avoisinantes, les Romains perdirent 15 000 hommes
et leur chef.
Des
218, au printemps, l'armée d'Hannibal s'ébranla vers
l'Italie. Elle n'etait pas mince: 80 000 hommes bien entraînés
qu'il amenait d'Espagne, mais les Romains pouvaient en aligner 200
000. Pourtant, la marche du chef punique à travers les Pyrénées,
le Languedoc, la Provence et finalement les Alpes elles-mêmes,
fut une étonnante série de victoires. Son habileté
maneuvriere, la puissance de son armement, incluant les fameux éléphants,
['endurance de ses troupes semèrent chez les Romains, pourtant
aguerris, la déroute, voire, souvent la panique. Le consul
Cornelius Scipion subit les premiers revers des l'automne de 218 sur
le Tessin. Un mois plus tard, ce fut le tour de son collègue
Sempronius a la Trébie. Ce qui compliquait singulièrement
les choses, c'etait l'appoint que les Carthaginois recevaient fort
opportunément des Gaulois, si bien que les Romains durent évacuer
en catastrophe la Gaule cisalpine. Encore n'avaient-ils rien vu. L'année.
suivante, en 217, le consul Flaminius se laissa surprendre en plein
brouillard au plus mauvais endroit: coinces entre le lac Trasimène
et les collines avoisinantes, les Romains perdirent 15 000 hommes
et leur chef.
 Mais
c'etait en 216 que les Romains devaient connaitre le pire, au point
que cette année pouvait apparaitre comme le commencement de
la fin. Après la défaite de Trasimène, on pouvait
considérer que la route de Rome s'ouvrait devant Hannibal,
qui pourtant ne profita pas des circonstances, puisqu'on le voit alors
obliquer vers le sud de l'Italie. Sans doute espérait-il soulever
la région avant d'en finir une bonne fois avec Rome. Le consul
Fabius, nommé dictateur en raison de l'état d'urgence,
avait pris la mesure du danger et de l'infériorité de
l'armée. Il fit en sorte de temporiser, d'éviter le
contact trop risqué, tout en entraînant ses troupes:
il y récolta le surnom de Cunctator, le temporisateur. C'etait
sage. Mais, point faible du système, deux nouveaux consuls
furent nommés en 216, qui rompirent avec la politique d'attentisme
de Fabius, et décidèrent d'engager une bataille près
de Cannes, dans la région des Pouilles.
Mais
c'etait en 216 que les Romains devaient connaitre le pire, au point
que cette année pouvait apparaitre comme le commencement de
la fin. Après la défaite de Trasimène, on pouvait
considérer que la route de Rome s'ouvrait devant Hannibal,
qui pourtant ne profita pas des circonstances, puisqu'on le voit alors
obliquer vers le sud de l'Italie. Sans doute espérait-il soulever
la région avant d'en finir une bonne fois avec Rome. Le consul
Fabius, nommé dictateur en raison de l'état d'urgence,
avait pris la mesure du danger et de l'infériorité de
l'armée. Il fit en sorte de temporiser, d'éviter le
contact trop risqué, tout en entraînant ses troupes:
il y récolta le surnom de Cunctator, le temporisateur. C'etait
sage. Mais, point faible du système, deux nouveaux consuls
furent nommés en 216, qui rompirent avec la politique d'attentisme
de Fabius, et décidèrent d'engager une bataille près
de Cannes, dans la région des Pouilles.
Les
conséquences fure,nt catastrophiques pour les romains car l'armée,
commandée par des gens courageux mais sans génie, y
subit la plus terrible défaite de l'histoire romaine. Des 80
000 hommes engagés, plus de la moitié trouvèrent
la mort ainsi que Paul Émile, l'un des consuls, 20 000 furent
capturés et 15 000 seulement furent ramènés sur
Rome par Varron, le second consul. Le spectacle du charnier éprouvait
les nerfs des vainqueurs eux-mêmes.
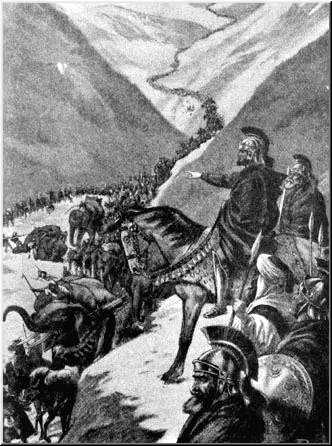 Hannibal
ne poussa pas ses avantages. Manqua-t-il pour la seconde fois sa chance,
comme on le dit parfois ? Plus probablement jugea-t-il que son armée,
forte surtout de sa cavalerie et en tout cas dépourvue du matériel
indispensable, n'etait pas appropriée au siège d'une
ville aussi importante? Dans son esprit, mieux valait sans doute couper
Rome de ses alliés méridionaux, qui du reste se soulevaient
déjà, et c'est ce qui le décide finalement à
s'installer un certain temps dans le sud de la péninsule. Politique
d'abord payante, puisque dès la mort du fiel roi Hiéron
II, Syracuse passait aux Carthaginois, de même que Tarente,
sans compter les assurances qu'Hannibal recevait du roi Philippe V
de Macédoine, intéressé par la région
de l'Adriatique.
Hannibal
ne poussa pas ses avantages. Manqua-t-il pour la seconde fois sa chance,
comme on le dit parfois ? Plus probablement jugea-t-il que son armée,
forte surtout de sa cavalerie et en tout cas dépourvue du matériel
indispensable, n'etait pas appropriée au siège d'une
ville aussi importante? Dans son esprit, mieux valait sans doute couper
Rome de ses alliés méridionaux, qui du reste se soulevaient
déjà, et c'est ce qui le décide finalement à
s'installer un certain temps dans le sud de la péninsule. Politique
d'abord payante, puisque dès la mort du fiel roi Hiéron
II, Syracuse passait aux Carthaginois, de même que Tarente,
sans compter les assurances qu'Hannibal recevait du roi Philippe V
de Macédoine, intéressé par la région
de l'Adriatique.
Le
séjour d'Hannibal à Capoue, qui s'etait rendue à
lui, ne fut donc pas sans profit, mais le malheur voulut, du moins
pour lui, qu'il s'y éternisas, l'expression "s'endormir
dans les délices de Capoue" vient de là, alors
que les Romains mettaient à profit ce temps mort pour se refaire
une santé. Ils étaient sagement revenue à la
position de Fabius Cunctator, la seule qui fut adaptée à
leur situation calamiteuse : temporiser, refuser le combat, recruter
et entamer des légions nouvelles. Tant et si bien qu'au prix
d'un effort surhumain, ils se trouvaient dès l'année
212 de nouveau pressé à reprendre les hostilités.
Ils ne devaient jamais oublier la sanglante leçon de Trasimène
et de Cannes dont le souvenir reviendra obstinément dans la
future littérature romaine.
Des 212, la République romaine passait à l'offensive
sur tous les fronts. On commence par contrarier Hannibal dans les
projets qu'il caressait touchant l'Adriatique: une escadre envoyée
sur place y mit fin, d'autant plus efficacement qu'une alliance conclue
entre Rome et quelques villes d'Asie Mineure incite le roi de Macédoine
à se tenir tranquille. Puis les choses allèrent bon
train. On reprit Syracuse en 211, après un siège ou,
par parenthèse, périt l'infortuné Archimède.
Occupé, dit-on, à résoudre quelque problème
de géometrie, il aurait simplement dit au soldat qui marchait
sur lui : "Ne dérange pas mes figures... "
Puis
on reprit Capoue et Tarente. On imagine que les retrouvailles ne furent
point idylliques avec les villes passées si imprudemment aux
Carthaginois ils méditeraient longtemps sur l'inconstance du
destin et sur les incertitudes des choses de la guerre. Sur le front
d'Espagne, où les affaires se présentaient d'abord moins
bien, l'illustre famille des Scipions sut retourner la situation au
profit de Rome. Cornelius Scipion, le tout jeune fils de ce consul
naguère vaincu sur le Tessin, était lui aussi un admirateur
fervent d'Alexandre le Grand. Il avait su observer la tactique d'Hannibal
et il allait avec génie la retourner contre l'inventeur. On
reconnait la, une fois de plus, la faculté d'adaptation des
Romains. En dépit de son jeune age, Cornelius Scipion avait
été nommé proconsul pour l'Espagne, et c'est
avec brio qu'il conduisit une série d'operations heureuses.
Il
ne put, certes, empêcher une armée punique, conduite
par le frère d'Hannibal, Hasdrubal Barca, d'échapper
à l'encerclement, mais ce fut sans conséquences, car
cet Hasdrubal ne put réussir à joindre l'arme d'Hannibal
et il trouva la mort en 207 sur les bords du Métaure. Scipion
poussa ses avantages en Espagne méridionale, s'empara de Gades
(!'actuelle Cadix) et, enhardi par ses succès, ce général
de vingt-cinq ans imagine un débarquement en Afrique, qu'il
décide en 204. Cette fois, l'opération réussit
: les Romains prirent pied à Utique et progressèrent
rapidement en territoire punique.
Scipion
en profita même pour s'allier au prince numide Massinissa, en
froid depuis peu avec Carthage: l'appoint de son excellente cavalerie
améliorerait encore les performances de l'arme romaine. Voyant
le tour que prenaient les choses et craignant pour la capitale toute
proche, les Carthaginois songeaient à la paix: il était
temps encore, pensaient-ils. de la conclure de façon honorable.
 Mais
Scipion exigea comme préalable à toute négociation
le rappel en Afrique d'Hannibal, qui devait évacuer l'Italie
de ses troupes. Le général punique étant "rentrer"
au pays, on put constater qu'il avait perdu la main. En 202, il fut
si bien vaincu à Zama que Carthage, redoutant le pire, se résigna
à capituler. Carthage devait livrer sa flotte, on voulait bien
lui laisser une dizaine d'unité, ses fameux éléphants,
cauchemar des Romains, et ses possessions d'Espagne. Les prisonniers
devaient être restitués et les déserteurs livrés.
Enfin, Carthage s'engageait à payer sur cinquante ans un tribut
colossal de 10000 talents, soit trois fois plus que lors du dernier
traité de paix, pourtant ruineux. II lui fallait bien sûr
renoncer à entreprendre quelque opération militaire
que ce soit sans l'aval du vainqueur. Autant dire que Carthage, qui
avait manqué vaincre, se retrouvait vassale de Rome : tout
espoir de redressement était désormais exclu. On pouvait
compter sur les Romains pour surveiller un ennemi qui lui avait tant
couté!
Mais
Scipion exigea comme préalable à toute négociation
le rappel en Afrique d'Hannibal, qui devait évacuer l'Italie
de ses troupes. Le général punique étant "rentrer"
au pays, on put constater qu'il avait perdu la main. En 202, il fut
si bien vaincu à Zama que Carthage, redoutant le pire, se résigna
à capituler. Carthage devait livrer sa flotte, on voulait bien
lui laisser une dizaine d'unité, ses fameux éléphants,
cauchemar des Romains, et ses possessions d'Espagne. Les prisonniers
devaient être restitués et les déserteurs livrés.
Enfin, Carthage s'engageait à payer sur cinquante ans un tribut
colossal de 10000 talents, soit trois fois plus que lors du dernier
traité de paix, pourtant ruineux. II lui fallait bien sûr
renoncer à entreprendre quelque opération militaire
que ce soit sans l'aval du vainqueur. Autant dire que Carthage, qui
avait manqué vaincre, se retrouvait vassale de Rome : tout
espoir de redressement était désormais exclu. On pouvait
compter sur les Romains pour surveiller un ennemi qui lui avait tant
couté!
Les
deux grandes figures de ce conflit, Hannibal et Scipion, allaient
connaître des destinées bien différentes. Hannibal,
envoyé par les siens en exil, s'en fut poursuivre en Orient,
dans le royaume de Syrie, la lutte contre Rome qui était sa
raison de vivre. Quant à Scipion, qui avait réussi au-delà
de toute espérance ce que le regretté Regulus n'avait
pu mener à bien en dépit de sa vaillance, il savourait
son triomphe.
Il
avait l'âme d'un roi et ne s'en cachait pas : il fit même
courir, dit-on, la rumeur de son ascendance divine, chose qu'on imagine
avec peine aujourd'hui. II ne manquait d'ailleurs pas de classe :
respectant son rival malheureux, il ne consentit jamais à ce
qu'on le livrât aux vainqueurs, estimant que ce n'etait pas
la un acte digne du peuple romain. Mais un destin ambitieux attendait
celui qu'on surnommait maintenant Scipion l'Africain : réaliser
une fusion plus étroite entre les traditions de la Rome antique
dont il était le plus beau fleuron, et celles de l'Orient grec
vers lequel les Romains ne tarderaient pas à se tourner.